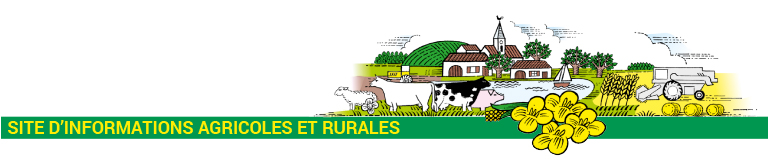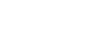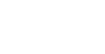Comment les acteurs économiques de la filière grandes cultures en Lorraine s’inscrivent-ils collectivement dans une dynamique positive ? Les exemples de la coopération agricole au service de l’innovation et d’une meilleure rémunération des producteurs.
Les acteurs majeurs de la céréaliculture lorraine ont saisi l’occasion de la célébration du centenaire de l’Association générale des producteurs de blé (Agpb) pour se déconnecter d’une actualité «qui trop souvent nous fait broyer du noir», expliquait Alain Brangé animateur d’une table ronde le 29 avril à Hauconcourt. Ses intervenants étaient invités à se projeter, aux fins de «créer une ambiance céréalière positive sur notre territoire».
Le choix du lieu pour cette célébration -à proximité immédiate des installations de stockage de céréales du port de Metz- invitait à débuter par un focus sur cet atout des filières locales de grandes cultures.
C’est par un peu d’histoire que Christian Sondag, président de Lorca, a entamé son propos. «Ce n’est pas l’agriculture qui a développé la Moselle canalisée, mais le charbon et l’acier» a-t-il rappelé, avant de montrer les liens profonds entre «l’histoire de la sidérurgie et celle de la production céréalière en Lorraine». Et d’évoquer la Communauté européenne du charbon et de l’acier, établie en 1951 pour favoriser la coopération économique ou encore «l’équivalent de 400 millions d’euros investis dans les années 60 avec l’inauguration en 1964 du port de Metz» dont la vocation était alors de «relier la sidérurgie lorraine au Rhin».
De l’acier au grain
«Nous avons la chance d’avoir la rivière Moselle qui rejoint la première voie navigable d’Europe, le Rhin», observe Christian Sondag, posant le constat d’une filière qui a su «profiter d’une opportunité». L’activité industrielle sidérurgique a aussi été facilitatrice d’emplois, libérant des surfaces agricoles nécessaires au développement et à la modernisation des exploitations qui se sont spécialisées dans la production céréalière.
Depuis, les investissements ont été nombreux. «Réalisés de façon intelligente», ils révèlent, «encore pour les plus récents», «des collaborations» entre les acteurs de la filière installés sur le port de Metz. «Aujourd’hui, sur la Moselle, personne ne charge de grains sans passer par une coopérative ou par leurs unions». Et pour illustrer le propos, Christian Sondag précise, «90 % de la collecte de Lorca sort par la voie d’eau».
Autre atout majeur pour cette filière, «le bassin de consommation que représente le nord de la France, le sud de l’Allemagne et le Benelux, à proximité».
Dans ce tableau idyllique, le président de Lorca relève «deux aléas principaux». Le plus «critique», «la situation du niveau d’eau sur le Rhin». En période de basses eaux, les péniches ne peuvent pas être chargées au maximum.
Le second concerne la conservation des grains dans les silos. «Les solutions chimiques sont de moins en moins faciles à utiliser, en particulier la désinsectisation». Dans ce registre s’ajoutent «des demandes des clients, pas toujours les mêmes, traitement chimique ou par le froid». «Il faudra trouver des solutions», Christian Sondag évoque la nécessité «d’un travail collectif» pour répondre aux attentes des clients.
Du grain à la tartine
Sur le même territoire, ce sont d’autres clients que le Groupement des producteurs de blé Dieuze-Morhange (Gpb) est allé chercher. À l’opposé des débouchés de l’Europe du Nord, Jean-Marie Guerber, président du Gpb, a présenté une solution locale de valorisation de la production collectée par sa coopérative. «La meunerie locale et allemande, ce sont 90 % de la destination des blés du Gpb». Mais la coopérative a souhaité investir plus loin dans son aval.
En janvier 2023, la reprise des Moulins Dubach s’est réalisée de façon conjointe avec Sanders Nord-Est.
La coopérative détient donc «le dernier outil de cette taille en Lorraine pour écraser du blé, 10.000 tonnes par an». Le débouché actuel des farines produites par le Gpb vise d’abord les artisans boulangers mosellans et alsaciens. Ils achètent 40 % de la production.
Les ateliers de panification des Gms pèsent, eux, 35 % de la farine produite à Sarralbe. Le reste est mis en marché dans les entreprises locales de l’agro-alimentaire. Et pour compléter cette stratégie «du grain à la baguette», Jean-Marie Guerber a témoigné d’un nouveau débouché pour la farine du Gpb, «les 500.000 baguettes» que le président du Département de la Moselle commande aux artisans boulangers pour alimenter les collèges. «Depuis début avril, le Gpb apporte une farine estampillée qualité Mosl» avec pour objectif de «permettre une meilleure rémunération pour le producteur».
Polyculteurs-éleveurs
Les interactions entre le monde du végétal et celui de l’animal ont été illustrées par le troisième intervenant. «La force du collectif nous a permis d’innover à la coopérative Emc2, avec deux unités de méthanisation mettant en lien les polyculteurs-éleveurs», explique Bruno Didier, président. En créant cette «nouvelle source de valeur», la vente de gaz vert, «la méthanisation est aussi une réponse agronomique pour apporter de la matière organique dans les sols des céréaliers lorrains, et pour solutionner partiellement les conséquences de la disparition des matières actives en désherbage», se félicite le président d’Emc2.
Cette offre d’énergie verte répond à une nouvelle demande sociétale de souveraineté énergétique. Dans le même sens, Bruno Didier souhaite aller plus loin, en affirmant «la place de l’agriculture comme un acteur des solutions dans les nombreux changements, climatiques, économiques, énergétiques». Emc2 se lance dans de «nouveaux projets de méthanisation avec la transformation des déchets produits par la population». Une stratégie basée «sur le collectif pour atteindre de la performance et susciter de l’émulation».
Le carbone
Autre sujet de société, le carbone. Comment intégrer dans le process de production des grandes cultures de nouveaux marchés ? Pour répondre à cette question, il a été fait appel à Pierre-Yves Simonin, président de la Cal. Il plante le décor en décrivant «un marché primordial», et «au-delà des enjeux de réchauffement climatique et de rémunération» qu’il représente, il y voit un véritable «outil de résilience par rapport à la qualité des sols en zones intermédiaires». Le carbone ou plus trivialement son équivalent «en matière organique» s’avère, pour lui, un avantage «dans la structuration du sol, dans sa capacité à résister plus facilement au stress hydrique, par exemple», sans oublier «son rôle dans la protection de la qualité de l’eau».
Quant à la rémunération attachée au carbone, Pierre-Yves Simonin a témoigné de la seule piste exploitée aujourd’hui par la coopérative, «les oléagineux bas carbone, à destination des biocarburants».
Investie depuis cinq années sur cette question de la rémunération liée au carbone, la Cal a également exploré les pistes de son aval avec les malteries et meuneries challengées sur la qualité de leurs matières premières. Mais «la performance économique de ces activités ne permet pas de donner du revenu complémentaire» malgré «les pratiques plus durables des apporteurs de céréales».
Le collectif
Acteurs économiques incontournables de la filière grandes cultures en Lorraine, les coopératives témoignent de la force du collectif qui traverse leurs initiatives, particulièrement en matière d’innovation. Mais toutes, malgré la puissance qu’elles représentent, se trouvent confrontées aux limites d’un carcan réglementaire de plus en plus pesant.
Le président de la Frsea Grand Est, Fabrice Couturier, a été sollicité afin d’apporter un éclairage sur la stratégie syndicale de la Fnsea dans la revendication de «changement de logiciel au service de la souveraineté alimentaire».
«Nous avons aujourd’hui plus d’entraves à la production et à l’exercice de nos métiers que d’encouragements», quand bien même «la puissance publique nous affirme la nécessité d’une souveraineté alimentaire retrouvée». Le constat posé par Fabrice Couturier tient du paradoxe, avec pour conséquence, «des filières agricoles nationales en situation défavorable par rapport à nos concurrents en Europe ou dans le monde».
Face à cette situation, le président de la Frsea a souligné «l’évidence d’un travail collectif» pour servir l’objectif des combats syndicaux, valorisant «la complémentarité de l’expertise des spécialistes dans les outils économiques, des métiers du grain notamment, avec la force du réseau syndical dans la structuration des synergies».
En lien avec les thématiques débattues, Fabrice Couturier s’est penché sur le travail de la Fnsea «dans la préservation des moyens de production, avec un focus sur l’avalanche d’interdictions dans la palette de produits phytosanitaires». Il relatait entre autres le travail sur l’utilisation du glyphosate «totem de nos adversaires» et «à nouveau autorisé pour une dizaine d’années», le lobbying sur l’accès aux nouvelles technologies (Nbt…) ou encore les combats sur l’entretien des cours d’eau, des réseaux de drainage. Et en termes de monnaie sonnante et trébuchante, le président de la Frsea Grand Est a souligné «le rôle du collectif au crédit des acquis» valorisés à plusieurs centaines de millions d’euros «d’aménagements fiscaux et d’aides directes». Il évoque «l’épargne de précaution, la fiscalité de la transmission, le Gnr, ou encore les aides directes pour le végétal» avec l’exemple de «l’accompagnement du plan protéines et les aides à l’investissement pour l’anticipation du retrait des substances actives et le développement de techniques alternatives».
Mais dans cette marche forcée, «où l’on nous demande de gros efforts dans un temps restreint, nous sollicitons une véritable planification», plaide Fabrice Couturier, «avec un pas de temps raisonnable et des moyens financiers».